|
Janvier 98, une terrible
tempête de verglas s'abat sur le sud-est du Québec.
Montréal est touché mais la Montérégie
subit les pires dégâts. Cette zone est baptisée
"Le triangle de glace". |
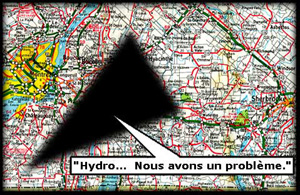 |
|
Photo et texte:
http://www.verglas.netc.net
Merci à
Michel! |
|
Le verglas constitue souvent le
pire danger qui nous guette en hiver. Plus glissante que la neige,
la pluie verglaçante est tenace et s'agrippe à
tous les objets qu'elle touche. En petite quantité, elle
est dangereuse, en grande quantité, elle est catastrophique! |
|
Les tempêtes de verglas constituent
une menace de taille pour toutes les régions du Canada,
à l'exception du Nord. Elles sont particulièrement
communes de l'Ontario jusqu'à Terre-Neuve. Leur gravité
dépend largement de l'accumulation de glace, de leur durée,
de l'endroit où elles se produisent et de l'étendue
des régions touchées. Selon ce critère,
le verglas de 1998 a été le pire qu'ait connu le
Canada de mémoire d'homme. Du 5 au 10 janvier 1998, il
est tombé, au total des quantités de pluie verglaçante
et de grésil entremêlés d'un peu de neige,
qui ont dépassé 85 mm à Ottawa, 73 mm à
Kingston, 108 mm à Cornwall et 100 mm à Montréal.
Les grosses tempêtes qui avaient déjà touché
la région, notamment Ottawa en décembre 1986 et
Montréal en février 1961, avaient déposé
entre 30 et 40 mm de glace, soit environ la moitié des
quantités enregistrées en 1998! |
|
Comble de malchance, la tempête
a malmené une des régions les plus peuplées
et urbanisées d'Amérique du Nord, laissant plus
de 4 millions de gens dans le noir et le froid pendant des heures,
sinon des jours. Il va sans dire que la tempête a directement
affecté plus de gens que tout autre événement
météorologique de l'histoire canadienne. Plus de
700 000 personnes sont toujours sans électricité
et ce pour une troisième semaine consécutive. Si
la tempête avait frappé à 100 km plus à
l'est ou à l'ouest de sa cible principale, son effet aurait
été beaucoup moins dévastateur. |
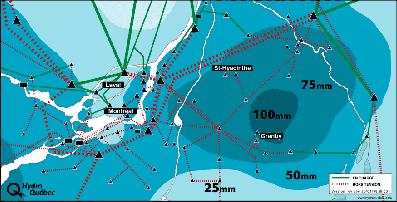 |
Image : Réseau de transport de l'électricité au pire de la tempête |
|
Quelques vidéos : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
|
|
Ce qui rend la tempête de
verglas inhabituelle, cependant, c'est sa durée. En moyenne,
Ottawa et Montréal reçoivent des précipitations
verglaçantes à 12 ou 17 occasions chaque année.
Chaque épisode dure généralement quelques
heures, ce qui donne une moyenne annuelle totale d'environ 45
à 65 heures. Cette année, les précipitations
ne sont pas tombées continuellement, mais le nombre d'heures
de pluie et de bruine verglaçantes a dépassé
80, soit environ le double du total annuel normal. |
|
Effets de la tempête
sur le Canada :
- Au moins 25 personnes sont mortes,
dont beaucoup d'hypothermie;
- Environ 900 000 foyers ont été
privés d'électricité au Québec et
100 000 en Ontario;
- Environ 100 000 personnes ont
dû se réfugier dans des centres d'hébergement;
sur une période de 24 à 48 heures,
- Certains ont dû faire
bouillir leur eau avant de la consommer;
- Les compagnies aériennes
et ferroviaires ont dû inciter les gens à éviter
la région touchée;
- 14 000 soldats (y compris 2
300 réservistes) ont été déployés
pour aider au nettoyage et aux évacuations et pour assurer
la sécurité;
- Des millions de résidents
des régions touchées ont dû vivre en transit,
visitant leur famille pour se laver ou partager leur repas ou
emménageant temporairement chez des amis ou dans un centre
d'hébergement;
- L'épisode prolongé
de verglas a détruit des millions d'arbres, 120 000 km
de lignes électriques et de câbles téléphoniques,
130 pilônes de transport évalués à
100 000 $ chacun et environ 30 000 poteaux de bois à 3000$
pièce.
|
|
Les dommages subis dans l'est ontarien
et le sud du Québec sont importants au point où
il faut procéder à une reconstruction majeure du
réseau électrique et non seulement à sa
réparation. Ce que l'être humain a pris un demi-siècle
à ériger, la nature l'a détruit en quelques
heures. |
|
Les agriculteurs, en particulier,
ont été durement frappés. Les producteurs
laitiers et les éleveurs de porc ont perdu l'électricité,
d'où la course effrénée aux génératrices
qu'ils ont dû se partager pour traire leurs vaches ou prendre
soin des porcs nouveaux-nés. Les acériculteurs
du Québec sont responsables de 70 % de la production mondiale
de sirop d'érable; beaucoup d'entre eux sont ruinés,
la majeure partie des érablières ayant été
détruites en permanence. |
|
|
|
|

